Écoanxiété: Des pensées noires malgré l'espoir
- Mackenzie Sanche

- 16 mai 2019
- 6 min de lecture
Dernière mise à jour : 10 janv. 2024
Mackenzie Sanche - Le jeudi 16 mai 2019

Les cataclysmes naturels se font de plus en plus sentir alors que le climat se réchauffe, emportant la santé de la planète vers la destruction. C’est la cause de l’apparition d’un nouveau phénomène, plus ou moins naturel, qui vient tirailler certaines personnes entre l’action et un nouveau mal : l’écoanxiété.
Phénomène de plus en plus médiatisé, l’écoanxiété est causée par un sentiment d’urgence, voire de détresse et d’impuissance face à la dégradation de la planète. « Ça t’inhibe complètement, ça te rend inefficace », explique Justine Davasse, fondatrice des Mouvements Zéro, ayant vécu de l’écoanxiété. Elle raconte un moment de sa vie où elle était zéro déchet et végane, en plus d’avoir tenté le crudivorisme et une alimentation sans féculents, donc sans gluten. « J’essayais d’incarner dans un seul corps, avec moi-même, tous les idéaux de fixer le monde entier avec mon comportement, et ça, clairement, c’était une mauvaise réponse à l’écoanxiété. »
Néanmoins, l’écoanxiété n’affecte qu’une minorité, selon Mélissa Tremblay, enseignante de sciences au secondaire et responsable de comités de jeunes engagés à l’Académie Lafontaine. Ce serait simplement un sentiment d’impuissance qui décourage la jeunesse. « L’an passé, les élèves me disaient qu’ils le savent que c’est terrible, qu’ils ne sont pas tannés d’en entendre parler, qu’ils sont juste un peu démunis », explique-t-elle. « Ils sont juste impuissants. Ils ne savent pas comment s’y prendre pour faire une différence et ils ont une mauvaise perception que ça ne vaut pas la peine d’essayer. »
Pourquoi cette impuissance ?
Membre du Parti Vert du Québec et conseiller en développement durable au Cégep de Saint-Jérôme, Joey Leckman pense que pour que la société adopte un mode de vie plus éco-responsable, le temps est de mise. « Ça demande beaucoup d’efforts pour faire un changement de schème. Un changement de mentalité, c’est excessivement long. Ça peut prendre des générations. » Tout de même, il demeure optimiste : selon lui, les jeunes ont beaucoup à dire dans les conversations environnementales, mais il comprend leur désarroi.
« Les jeunes voient les chiffres pour 2050, mais quand toi, tu peux te dire qu’en 2050, tu vas être mort, eux se disent que c’est peut-être l’âge auquel ils auraient des enfants et qu’ils ne veulent pas élever des enfants dans un monde comme ça », dit M. Leckman. C’est de là que peuvent jaillir des symptômes écoanxieux. Mme Tremblay aussi ressent le découragement au sein de ses jeunes engagés. « Sans qu’on soit essoufflés, on avait l’impression qu’il y avait juste nous qui croyons que c’est important. »
Pour sa part, Joey Leckman croit que la cause de l’inaction des jeunes est la saturation. En effet, ils auraient été trop exposés aux enjeux climatiques et la situation s’est normalisée pour eux, ce qui explique des pensées comme celles énoncées par Mme Tremblay : « Dans la classe, il y en a qui disaient que ça ne vaut pas la peine, parce que si en haut ça ne bouge pas, même si je faisais mon composte et que je consommais moins, qu’est-ce que ça changerait? »
Tout au contraire, M. Leckman ne croit pas que ce sont les petites actions et les petits boycotts qui vont changer la donne. « Ça presse. On ne peut plus juste faire des petits gestes et trouver ça cute, il faut faire des gestes plus gros. » Tout de même, des symptômes d’écoanxiété peuvent se manifester chez des optimistes aussi dévoués que Joey Leckman. « J’aimerais ne pas sentir ce devoir envers la planète. J’aimerais ça m’en foutre, comme d’autres personnes. J’aimerais ça ne pas m’en soucier. »
« On est juste submergés, noyés, et on ne sait plus c’est quoi le choix qu’on doit faire », ajoute Mme Davasse. Cependant, il faut avoir de la perspective pour atteindre ses objectifs environnementaux, affirme M. Leckman. « Moi, je vois ça 500 ans. Si ta décision est bonne pour dans 500 ans, c’est bon. Si tu as le moindre doute, ce n’est pas bon. C’est 500 ans, pas 50. Sept générations. »
L’écoanxiété : un nouvel outil
Mme Davasse explique que le fait d’avoir découvert le terme « écoanxiété » lui a permis de mieux apréhender ce qu’elle voulait ressentir et de mieux gérer ses émotions. En ayant pris conscience de cela, elle peut s’assurer de maintenir une bonne hygiène mentale qui ne l’épuise pas et qui lui permet d’être plus proactive quant à ses actions pour l’environnement. « C’est comme si j’avais une corde supplémentaire à mon arc », spécule-t-elle. L’écoanxiété lui sert de point de départ.
« Tu peux être la solution, ou tu peux être le problème », insiste M. Leckman. Il explique que dans une voiture qui fonce à pleine vitesse vers un mur de brique, il est possible soit de freiner pour au moins atténuer le coup, même si l’impact est inévitable, ou bien d’appuyer davantage sur l’accélérateur pour s’assurer de bien le heurter.
L’écoanxiété sert donc d’élan vers l’action pour le climat. Récemment, les jeunes se mobilisent et se font entendre, principalement grâce à des mouvements comme des manifestations et des grèves étudiantes. « On ne peut pas revenir en arrière », se désole Mme Tremblay, « mais on peut sauver ce qu’il reste. Il reste peu de temps, mais là, il y a une vague de fou, on a un momentum incroyable ! » Selon elle, la solution est dans la consommation. Recycler, composter, oui, mais d’abord, moins consommer. Elle souhaite que la société devienne une société de décroissance et qu’elle valorise le durable plutôt que l’économe.
Pour M. Leckman, la clé du succès est dans le vote. Il dit avec détermination de travailler sur le macro, d’aller voter, de parler de politique et de contaminer ses amis. Il illustre l’impact de la politique en disant qu’avant, il faisait 13 000 gestes pour l’environnement, mais que maintenant, il peut passer un règlement qui force 13 000 personnes à faire le geste. « Mon rêve ultime, c’est qu’on se retrouve avec une quantité immense de jeunes qui iront voter. Si 95% des jeunes allaient voter, je pense que dans l’espace de 5 ans, notre pays serait complètement différent. »
Quant à Justine Davasse, il est important de se réapproprier les compétences qui ont été données ou volées par les supermarchés et la politique. Le monde est trop centralisé et interconnecté, alors une crise économique dans un pays peut affecter le monde entier. Par conséquent, elle croit qu’il devrait y avoir des organismes de résilience dans les communautés qui développent des compétences survivalistes comme la cuisine, le combat, la conserverie, le jardinage, la construction, et autres. « Chacun fait à la hauteur de ce qu’il sait faire. Moi, je sais écrire et informer les gens », rit-elle, faisant référence à son site Les Mouvements Zéro.
Surmonter cette déprime planétaire
« Si on est écoanxieux, c’est un signe de bon fonctionnement mental. J’ai du mal à conceptualiser le fait qu’on ne ressente rien face à la catastrophe environnementale qui est devant nous », dit Mme Davasse, qui est toujours émerveillée qu’en Indonésie ou dans des pays très pauvres, il y a des entrepreneurs qui ont pris conscience de l’enjeu du plastique, tandis que les pays riches se permettent d’ignorer la pollution. Les gens écoanxieux vont pleurer, avoir des douleurs physiques et être en colère, mais il est crucial de ne pas rester à ce stade, selon elle. Il faut être en paix avec soi et avec le monde pour arriver à faire une différence.
Mme Tremblay, de son côté, croit que l’on perd du temps à répéter aux gens toute l’information sur le CO2, sur le composte, car ils le savent. Maintenant, il faut des actions concrètes. Ça ne vaut pas la peine d’être en panique. Pour réduire cette anxiété-là, à son avis, il faut se mettre en action et en se concentrant sur le positif.
Nonobstant, la réalisation que l’on ne peut pas tout faire, et encore moins par soi-même, est déjà un grand pas pour atteindre une certaine paix d’esprit qui réduirait l’écoanxiété. Par contre, malgré que ce stress environnemental ne soit pas une dépression, c’est tout de même un trouble anxieux qui peut être nuisible à la santé mentale, d’où la recommandation de Mme Davasse : « Il est important d’avoir un dialogue avec soi-même, avec un professionnel de santé, ou avec un groupe de soutien pour régler son écoanxiété. »
Malgré tout, elle croit que les domaines professionnels de la santé devraient prendre au sérieux l’écoanxiété. « On a besoin qu’ils reconnaissent ça comme un vrai mal. »
Ce que l’écoanxiété dit sur nous
Vivant dans un monde qui est déjà plus exposé aux nouvelles inquiétantes et à l’information alarmante, il est normal que la société soit anxiogène. Mme Davasse insiste sur le fait que l’écoanxiété est un luxe chez les Occidentaux que les pays plus démunis n’ont pas. L’accès à l’éducation et à l’information est une source importante de stress, mais dans l’urgence, la population n’aura pas le temps d’être écoanxieuse. Elle devra agir pour assurer la survie de l’espèce.
L’écoanxiété est un phénomène qui prend de plus en plus d’espace, principalement parce que c’est un mal global, selon Mme Davasse. « La perte de l’environnement est quelque chose qui est plus fort que de perdre ses parents ou ses grand-parents, c’est une douleur immense, et c’est une douleur plus globalisée au niveau de la population. » C’est carrément la perte de son milieu de vie et de sa possibilité d’exister. « Ça demande beaucoup d’humilité de reconnaître qu’on s’est vraiment trompés », évalue Joey Leckman.
Ce stress environnemental en dit long sur la société. Elle miroite son anxiété, sa vulnérabilité, ainsi que son amour. Au final, comme le dit si bien Justine Davasse, « être écoanxieux, c’est avoir aimé un jour l’environnement dans lequel on est et d’un coup ressentir le fait qu’il est en train de s’effondrer ».
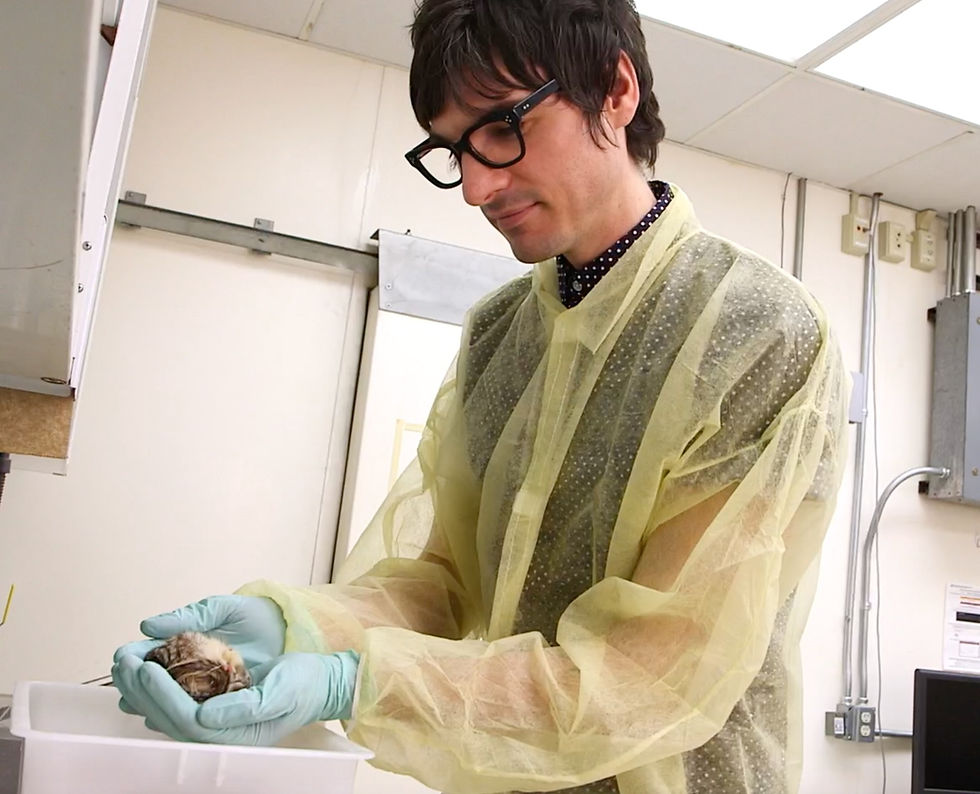

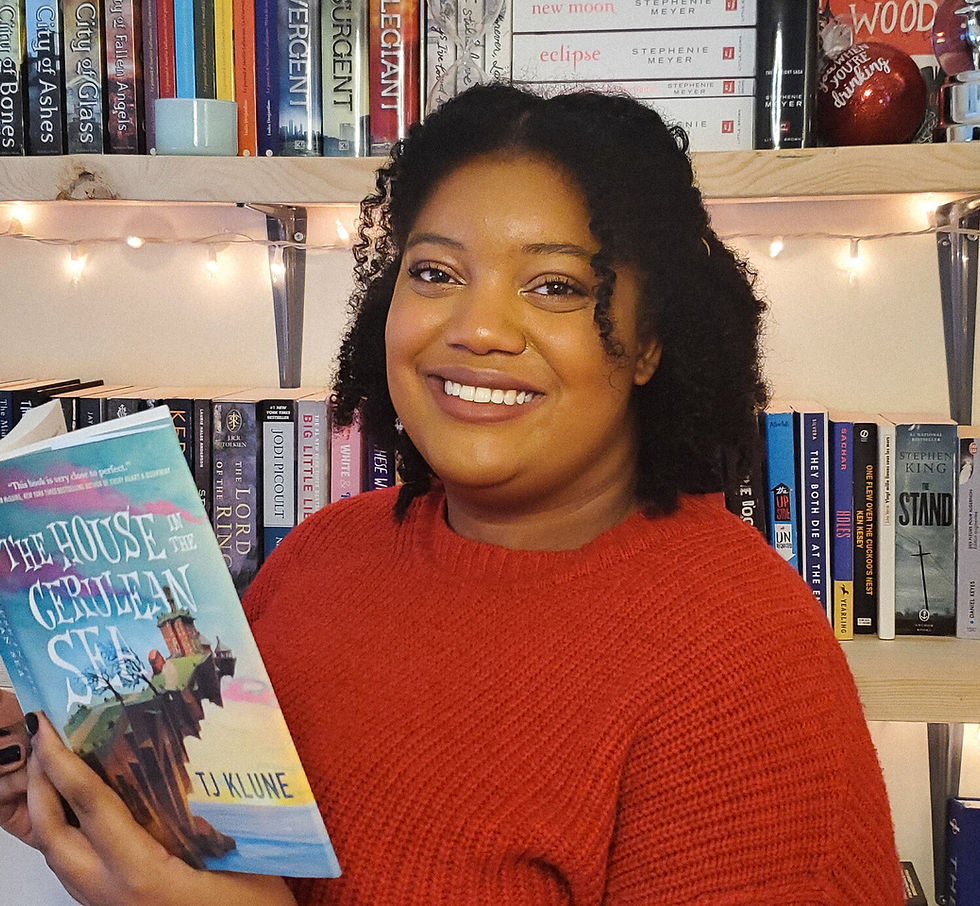
Commentaires